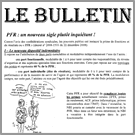Editorial de la lettre des administrateurs civils de Bercy.
 octobre 30, 2008
octobre 30, 2008
J’ai assisté ce mois-ci à une scène d’un surréalisme vertigineux : devant ses collaborateurs réunis, le (très) haut responsable d’un service prestigieux de l’État – n’allons pas plus loin vers une possible identification qui serait, comme l’on va voir, désobligeante – se livre soudain à un commentaire angoissé de l’actualité économique.
Avec aisance, cette brillante mécanique intellectuelle confie à un auditoire respectueux et médusé son anxiété devant « les turbulences météorologiques financières », rythmant un épanchement de plus de quinze minutes par des chiffres précis, taux d’intérêt, croissance, environnement international, fragilité des banques …
« Peur », « anxiété », « inquiétude », sont les mots qui reviennent alors plusieurs fois dans cette analyse pourtant chiffrée, cette confidence tourmentée …
Comment expliquer qu’une donnée de conjoncture financière, grandeur désincarnée par excellence, recueille un traitement émotif ? Comment un général, devant la troupe qu’il doit encourager, en vient-il à confesser sa peur ? Pourquoi l’actualité conduit-elle ici jusqu’à l’allongement sur le divan ?
Car on est bien ici dans la psychanalyse. Si toute peur parle bien de l’inconnu, alors nous tenons sans doute une hypothèse d’explication. Pour faire face aux peurs, on les travestit, on en change l’image. D’une crise profonde, on fait un épisode météorologique. D’une angoisse aux causes trop graves pour être reconnues, on extrait une dissection raisonnée de mécanismes chiffrés, rationnels, explicables.
Mettons de côté les imprécisions de management du responsable timoré. Les symptômes qu’il décrit sont faux : la crise est profonde. Elle n’est pas financière, ni faite de mauvais chiffres, ni même rationnelle.
Allons courage ! Envisageons bravement ces fantômes ennemis que nous n’osons voir. Il se nomment valeurs perdues, intérêt collectif oublié, communauté de destin incertaine, bien commun refoulé. Ces chiffres terrifiants dont la danse nous devient insupportable ne sont en réalité que les traductions conscientes de nos faiblesses et de nos oublis, inconscients ceux-là.
Par extension, comment être un bon représentant syndical si l’on ne pense pas à chaque instant à l’intérêt collectif ? Quelle signification, pour les régimes indemnitaires, les valeurs indiciaires … si ceux-ci ne sont pas compris comme des instruments au service d’un projet plus grand ? Ce ne sont pas de grands mots vides. Travailler à la préservation des conditions de travail n’a de sens que dans la recherche du meilleur service public. Exiger de soi-même le meilleur pour les autres rend légitime pour rappeler ces mêmes autres à leur devoirs.
Cet exemple assez attristant d’un chef qui s’assoit en pleurant au milieu du champ de bataille, manquant de caractère, ne sachant plus pourquoi il se bat, doit nous galvaniser : redoublons d’efforts, participons, vigilants et de bonne volonté, aux projets qui sont déjà sur l’atelier ! Experts de haut niveau, mobilité, revalorisation du statut, et plus généralement révisions générales des politiques publiques.
Le syndicalisme, par devoir, par engagement, doit porter haut ces valeurs dont l’abandon conduit aux angoisses que l’on a vues. Quand on veut le projet commun, les querelles paraissent dérisoires, les corporatismes apparaissent médiocres, le découragement ne semble pas permis. Quand on veut le projet commun, on est écouté par l’administration. Animé de ces mêmes principes qui doivent en toute circonstance guider l’action publique, notre action, on en est légitimement le partenaire, rugueux peut-être, respectable toujours.
Jean CARLIOZ
Président de l’USAC
 Posted in
Posted in